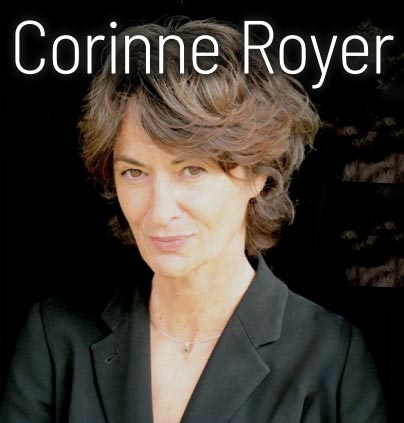
Interview de Corinne Royer, auteure de « Pleine Terre » (Actes Sud)
1/ Quelques semaines après la sortie de votre dernier livre et suite aux premiers retours médiatiques, deux prix littéraires et déjà de multiples rencontres avec les lecteurs, quelles sont les réactions qui vous ont le plus touchée et quel est votre sentiment face à certaines analyses qui présentent votre roman comme un texte engagé ?
Oui, « Pleine terre » est paru en cette rentrée et l’accueil fait à ce texte me réjouit. C’est un roman qui interroge notre modèle de société, il dit le chaos qui épuise à la fois les hommes et les réserves de beauté du monde. En abordant la question du malaise paysan contemporain, c’est notre rapport au monde qui nous entoure que j’ai souhaité explorer, c’est aussi notre rapport à nous-mêmes : que sommes-nous prêts à accepter, à quelles injonctions sommes-nous prêts à nous plier et quel élan, en nous, individuellement et collectivement, peut nous permettre de dire non, de refuser un système productiviste devenu délétère et inhumain ? Je crois que les lecteurs se reconnaissent dans toutes ces interrogations et c’est bien ça, la vocation du roman, le sillon qu’il doit creuser : questionner, interroger l’histoire, le présent et l’avenir. Kundera a dit « le roman a question à tout, il doit bousculer les certitudes humaines », et je garde l’espérance qu’en creusant ce sillon-là, la littérature peut à la fois réveiller nos facultés d’indignation et révéler ce qui reste de nos capacités d’émerveillement. Beaucoup de lecteurs ont retrouvé dans Pleine terre des sensations un peu oubliées, une attention à une nature et un environnement trop souvent malmenés, une émotion face à l’injustice et aux aberrations d’une administration dont la violence des méthodes est devenue systémique, et qui oublie que derrière les chiffres, les numéros de dossiers, les tonnes de paperasses sans cesse plus contraignantes, se trouvent une réalité qui reste du domaine du vivant : des femmes, des hommes, des bêtes, des plantes, des arbres etc… Alors, oui, ce qui me touche peut-être le plus dans les retours des lecteurs, c’est cette conscience aiguisée, ces yeux qui s’ouvrent sur la nécessité de ne plus nous laisser bercer par les fausses promesses, celles de la modernité, de la folle allure, de la sur-réglementation pour retrouver du sens et de la fraternité. Et cette dimension, bien sûr, nous entraîne parfois sur les voies de l’engagement et du politique.
2/ Votre texte est inspiré d’un fait divers récent, pourquoi avoir choisi la forme romanesque plutôt que le récit journalistique ?
D’abord parce que je suis romancière et non pas journaliste ! Pleine terre s’inspire effectivement d’un fait divers de 2017, je préfère d’ailleurs le terme « fait de société » à celui de « fait divers ». Il s’agit d’un agriculteur de Saône et Loire, Jérôme Laronze, que les petites mains de l’administration ont harcelé, humilié pendant trois ans parce qu’il refusait le modèle aujourd’hui imposé aux petits paysans, puis que le bras armé de cette même administration a poursuivi comme un criminel pendant neuf jours. En août dernier, Florence Aubenas a publié dans Le Monde six articles qui retracent cette histoire tragique en s’appuyant sur une enquête journalistique auprès de proches, de voisins etc… Il s’agit donc d’un récit le plus objectif possible. Pour ma part, en tant que romancière, cette question de la relation objectivité/subjectivité est au coeur de mon travail et, en donnant voix à des personnages de fiction, je peux échapper à une nécessaire objectivité, je peux transmettre une vérité parmi d’autres, celle de mes personnages selon la place qu’ils occupent, selon le regard qu’ils portent sur le monde. En cela, le roman me libère de la notion de portrait réaliste et Jacques Bonhomme, le personnage principal du roman, n’est en aucun cas le portrait du personnage réel. La fiction permet également de fouiller là où l’enquête journalistique revient parfois bredouille, c’est à dire dans les blancs d’une histoire, dans cet espace et cette temporalité où personne ne peut témoigner car personne ne sait ce qui s’est passé. C’est le cas pour les neuf jours de cavale du personnage et c’était là un formidable matériau romanesque.
3/ Certains thèmes semblent présents dans chacun de vos romans, la dépossession, l’effondrement, le vacillement des êtres et « Pleine terre » n’échappe pas à ces thématiques. Est-ce un délibéré ?
Les personnages de roman sont des êtres comme chacun d’entre nous. Peu importe qu’ils soient agriculteurs, ouvriers, médecins… ils sont d’abord des femmes et des hommes. Ils ont leur histoire, leur héritage plus ou moins joyeux, plus ou moins lourd à porter, leurs doutes, leurs douleurs, leurs espérances. Et nous connaissons tous ces moments de l’existence où tout ne tient plus qu’à un fil, cette sensation d’être tout près du vacillement. La littérature peut être un formidable révélateur de ce sentiment, de cette fragilité des êtres face à l’existence. Et il me semble intéressant de fouiller cette question : pourquoi on tombe et à quoi on peut se raccrocher lorsque l’on tombe ? Aux souvenirs, à la famille, à la force des liens affectifs, à une certaine forme de spiritualité… Explorer cette thématique ne nous garantit pas de façon certaine de ne plus tomber, de ne plus ressentir de désespoir, mais sans doute cela nous permet de ne pas sombrer totalement, de lutter en connaissance de cause. Jacques, dans « Pleine terre », fait l’apprentissage de ce vertige, du fait de se tenir au bord du gouffre, et sa révolte lui offre la possibilité de rester debout aussi longtemps que possible. Il est un peu comme l’homme révolté de Camus : il refuse mais il ne renonce pas, il ne veut pas que ses espérances soient confisquées. Si la littérature peut nous enseigner ce tour de force, rester debout dans la tourmente, demeurer digne et combatif, alors, oui, la littérature m’intéresse et va encore m’intéresser quelque temps…
4/ Certains disent que la littérature est le dernier espace de liberté ; qu’en pensez-vous ? La littérature peut-elle changer le monde ?
Je pense que toute forme d’expression artistique est et doit rester un espace de liberté. Longtemps, je me suis posé la question de la légitimité. Qui sommes-nous, nous, auteurs, réalisateurs, créateurs… pour nous emparer de grands sujets de société ou, au contraire, d’histoires intimes et pour les retranscrire à notre façon ? En réalité, la seule réponse possible est celle qui se situe dans le champ de l’empathie, de ce sentiment étrange, à la fois angoissant et rassérénant, d’appartenance à la communauté des hommes. Si j’écris, si je raconte une histoire en me plaçant à cet endroit précis, au centre de la communauté des hommes, je peux parler de tout, je suis légitime à parler de tout. Il se trouve que je vis au milieu des fermes et des agriculteurs et que « Pleine terre » est donc nourri de nombreuses conversations, de nombreux échanges et partages avec ceux qui m’entourent au quotidien mais j’aurais très bien pu écrire ce texte en venant d’ailleurs, d’une grande ville par exemple, mais en me rendant poreuse à ce monde paysan par le simple fait que le drame qui le secoue me touche, m’émotionne, m’interpelle. Je crois que la force de la littérature de fiction se tient là, à la croisée des chemins entre l’intime et l’universel, et si l’on veut bien imaginer que la littérature pourrait se résumer à cette possibilité de rester poreux au monde et à l’Autre, alors, oui, elle peut changer les choses, ou, en tout cas, changer notre façon d’éclairer le monde, de souligner ses zones d’ombres et d’atténuer le clinquant de certaines fausses lumières. Il faut pour cela beaucoup regarder, beaucoup entendre, et beaucoup apprendre de ce qui opère dans les corps et les coeurs de nos semblables et qui n’est jamais qu’un miroir de notre propre humanité, de nos propres défaillances comme de nos grandeurs. Cette exploration est sans bornes, sans limites, elle est aussi vaste que les oscillations de l’âme humaine, elle se calque sur son amplitude, entre le pire et le meilleur…
